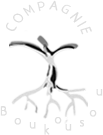MASONN à ISTANBUL : La presse en parle !
Unlimitedrag – 25 septembre 2025
Dans le cadre du FRINGE INSTABUL FESTIVAL
En turc dans l’article. Traduction ci-dessous :
Conversations en dix questions : Max Diakok, Patrick Blenkarn et Milton Lim
La 7e édition du Festival Fringe d’Istanbul, qui se déroule cette année du 19 au 27 septembre, propose 10 spectacles locaux et 10 spectacles internationaux dans 15 lieux différents de part et d’autre de la ville. Nous avons rencontré Max Diakok, du spectacle Masonn, qui propose une programmation interdisciplinaire et multiculturelle, ainsi que Patrick Blenkarn et Milton Lim, créateurs d’asses.masses.
——————–
Notre premier invité est le chorégraphe français Max Diakok, qui présentera au festival son spectacle « Masonn ». Danseur et chorégraphe guadeloupéen, Diakok découvre le gwoka en 1978 lors de ses études de judo. Au cours des années suivantes, il étudie le modern jazz, le modern ka, la danse classique et la danse contemporaine à Toulon, en France, et travaille avec des chorégraphes tels que Paolo Campos, Germaine Acogny, Jean François Duroure, Pierre N’Doumbé, Christian Bourigault et Norma Claire, ainsi qu’avec des metteurs en scène comme Luc Saint-Éloy du Théâtre de l’Air Nouveau et Jean Michel Martial. En 1996, Diakok intègre propre la Compagnie Boukousou en tant que chorégraphe, à Saint-Denis, en banlieue parisienne.
Gardant à l’esprit sa recherche de nouvelles formes de mouvement et désireux d’acquérir d’autres outils techniques, Max Diakok continue d’utiliser le vocabulaire gwoka dans son travail, se concentrant principalement sur la danse contemporaine, la danse africaine et les techniques corporelles telles que le yoga, le buto et la danse-contact. Il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres en France en 2015. La compagnie de Diakok, la Compagnie Boukousou, présentera le spectacle Masonn au Studio Zorlu PSM %100 le 25 septembre 2025, dans le cadre du festival.
——————————-
Selon vous, quelle est l’essence de la performance ?
C’est à la fois un état de plénitude et de vide. La plénitude est la présence intérieure de l’artiste. Il porte en lui des bagages essentiels tels que la conscience corporelle et la mémoire de diverses expériences. Le vide est la capacité à s’adapter, à être ici et maintenant sans préjugés. Cela exige une connexion holistique avec soi-même, l’espace, la musique/le temps et les partenaires potentiels. Cette présence se réalise par la respiration, qui nous relie à l’énergie, et par l’ancrage, qui nous relie à la Terre.
Croyez-vous au pouvoir transformateur de l’art ? Comment ?
À mon avis, l’art est un outil de transformation important. Cela est indissociable d’une connaissance de soi croissante ; de la connaissance de toutes les composantes de son être, du corps physique à l’énergie subtile qui l’anime, en passant par les pensées et les émotions. De plus, la création artistique requiert la collaboration des deux cervaux Cette connaissance de soi est le fondement de l’estime de soi. Oser s’exprimer artistiquement est le premier pas vers la libération des attaches, qu’elles soient familiales ou sociales.
Quelles sources vous inspirent lorsque vous travaillez sur une œuvre ? Les rêves jouent-ils un rôle dans votre travail ?
L’idée initiale d’une œuvre peut naître de l’observation du mouvement des gens, du rythme qu’ils créent en marchant ou en courant, de la géométrie de leurs mouvements et des émotions qu’ils suscitent en moi. Cette première ébauche peut être nourrie par des lectures, comme dans mon œuvre Depwofondis (mot inspiré du psaume De profundis), parue en 2014, qui interroge le monde et son rapport au temps, nous invitant à ralentir et à nous lancer dans un voyage intérieur. Après m’être inspiré des mouvements et des expressions qui émergent dans le métro ou dans la rue, j’ai lu La Conférence des oiseaux du poète persan Fariduddin Attar et L’Éloge de la marche de David Le Breton. Ces lectures m’ont permis de développer l’œuvre sur le mode du voyage initiatique. De même, dans Poulbwa ! (Attention, termites !), je me suis inspiré d’images liées à la société de consommation, aux addictions et à la publicité. Par ailleurs, ma première pièce, créée en 1996, « Driv » (déambulation), est née des frustrations que j’ai éprouvées en tant que nouvel arrivant en France. Cette création mettait en avant l’histoire de la Guadeloupe, notamment son passé esclavagiste, et évoquait des personnages tels que les nègres marrons et le virtuose du tambour, Vélo. Pour cette œuvre, je me suis inspiré d’éléments iconographiques et du film Sankofa du réalisateur éthiopien Haïle Gerima.
Pour « Masonn » (Murs), le déclencheur a été les débats médiatiques autour de l’immigration et l’appel de deux écrivains martiniquais, Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, intitulé « Quand les murs tombent ». Ce livre répondait au projet de création d’un ministère de l’Identité nationale.
Enfin, les œuvres, quelle que soit leur source d’inspiration, passent toujours par un filtre poétique. C’est une phase de distanciation où je dépasse le premier degré pour imaginer un langage allégorique. Ainsi, le rêve ne fait pas partie de mes sources d’inspiration, mais la rêverie éveillée me permet d’entrevoir ce langage poétique.
Quand décidez-vous de donner un titre à l’œuvre sur laquelle vous travaillez si elle n’en a pas déjà un ?
Le titre est généralement la dernière chose qui me vient à l’esprit. Le titre initial apparaît souvent pendant les répétitions, mais la pièce évolue et devient si spécifique qu’elle exige un autre titre. Le véritable problème réside dans le fait que l’équipe de production a besoin d’un maximum de données pour solliciter des subventions ou des dates de représentation auprès de diverses institutions ou salles. Les demandes sont souvent soumises avant la fin de la pièce, voire avant le début des répétitions. Dans ce cas, nous indiquons qu’il s’agit d’un titre provisoire.
Y a-t-il des artistes ou des personnes qui ont influencé votre art ? Si oui, lesquels ?
Je ne peux pas dire qu’un artiste en particulier ait le plus influencé mon art. Mais dès le début, grâce au travail d’artistes plus âgés que moi, j’ai eu une idée de la voie à suivre. Et cette voie s’est éloignée des normes occidentales. Elle est née grâce à une compagnie de théâtre, le Théâtre du Cyclone, qui explorait une théâtralité et une gestuelle inspirées par les personnes vivant dans des conditions modestes, notamment celles des zones rurales.
Il y a aussi Gérard Lockel, le père fondateur du gwoka moderne, un musicien qui a choisi de s’exprimer à travers les gammes atonales et modales héritées de notre histoire musicale depuis la déportation des esclaves et non à partir de la gamme tempérée. Même si, dans les deux cas il s’agit d’une influence indirecte, ces exemples m’ont aidé à comprendre la nécessité du marronnage esthétique pour éviter de rester enfermé dans une norme universalité conçue comme norme unique s’appliquant à tout le monde. Chose pas évidente au début d’une carrière où il faut se former et faire ses preuves. Beaucoup plus tard, j’ai eu une révélation à travers la danse Butoh, en particulier la compagnie Sankaï Juku du chorégraphe Ushio Amagatsu. En voyant ses corps prostrés, les jambes en dedans, j’ai tout de suite ressenti le parallèle avec certaines danses du Gwoka.
Si vous considérez l’état actuel du monde sous tous ses aspects, quel est le problème le plus important et le plus urgent pour vous en tant qu’artiste ?
Dans de nombreuses régions, les peuples sont confrontés à des troubles majeurs. Si ce n’est pas la guerre c’est l’iminence ou la menace de celle-ci. D’autres sont carrément menacés par un génocide. Ajoutés à cela les dangers climatiques qui pèsent sur notre planète, l’accentuation de la prédation néolibérale, l’accroissement de la précarité, le recul des démocraties, la montée des fascismes. Que peut l’art face à cet état de fait ? Pas grand-chose. Toutefois l’art contribue à semer des graines. Et quand ces graines poussent, elles permettent de culbuter les vieux paradigmes.
Un des enjeux c’est de résister aux vautours de l’économie, qui sont prêts à faire de l’art une marchandise ordinaire. C’est pourquoi il est nécessaire de créer à partir de son authenticité et non à partir de modes et de besoins créés artificiellement.
Par ailleurs, et c’est le deuxième enjeu, je crois beaucoup en la transmission. Disséminer la Beauté, faire en sorte que l’art, quel qu’il soit, soit présent partout, c’est préparer les générations futures à un imaginaire ouvert, loin de tout mur.
Si l’on ne se trompe pas, vous mélangez le gwoka et le hip-hop dans votre approche chorégraphique. Pourriez-vous nous parler des origines du gwoka en tant que style de danse et de votre relation avec lui ?
Je tiens à préciser que je ne suis pas un danseur de hip hop. J’ai voulu faire cette expérience avec une danse différente mais cousine (surtout dans le jeu de jambes de la house dance). Mon ADN c’est la danse Gwoka.
Qu’est-ce que le gwoka ? C’est à la fois une danse et un style musical d’origine afro-guadeloupéenne. Il a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2014. Pour comprendre ses origines, il faut remonter au XVIIe siècle, lors de la déportation des esclaves africains vers les Caraïbes, et plus précisément vers la Guadeloupe. Ces divers groupes ethniques ont fini par créer une langue commune, le guadeloupéen (plus communément appelé créole), ainsi qu’une musique et une danse communes qui deviendront plus tard le gwoka. L’adoption généralisée de ce nom remonte au XXe siècle. Bien sûr, c’est une expression d’origine africaine, mais sa principale caractéristique est qu’il s’agit d’une création originale, même si elle contient des éléments proches du Congo et de l’Afrique de l’Ouest.
Le gwoka n’a pas seulement une fonction réjouissance. Autrefois pratiqué lors des travaux agricoles, il est devenu au fil du temps un élément symbolique de l’identité guadeloupéenne. Il porte en lui la mémoire de la résistance contre la déshumanisation et la déculturation. Autrefois, il a été soumis à des interdits, des humiliations, voire à de l’autodénigrement. Dans les années 1970, il est devenu une arme identitaire brandie par le mouvement indépendantiste. Aujourd’hui, il est omniprésent (sauf à la télévision publique française). Il accompagne les grèves et les manifestations politiques. Il peut également être porteur d’une dimension spirituelle.
Le gwoka est également présent sur scène ou dans des lieux dédiés aux arts : concerts, spectacles de danse, pièces de théâtre, performances d’arts visuels, etc.
Depuis mes débuts dans la composition chorégraphique, je l’utilise de manière contemporaine, décontextualisée. Pour moi, il ne s’agit pas d’en reproduire les codes, mais de m’inspirer des états corporels qu’il véhicule, de me laisser traverser par une mémoire ancienne en écoutant mes émotions et mes rythmes intérieurs, et de maintenir une certaine porosité dans ma relation au monde. Il en est de même pour la musique qui accompagne ma danse. Elle peut être détournée sans l’ostinato des tambours, ou accompagnée par la musique électro-acoustique.
Avant d’aborder mon modus operandi, je tiens à préciser que ce thème de l’altérité s’inspire de concepts développés par le philosophe martiniquais Édouard Glissant.
– Celui d’identité. A la conception essentialiste d’identité-racine, il préfère celle d’identité-rhizome. La racine unique étant celle qui tue autour d’elle, alors que le rhizome est la racine qui s’étend à la rencontre d’autres racines.
– Celui de relation. Il s’agit d’un mode d’être au monde fondé sur la mise en contact, l’échange, l’interdépendance. Il s’oppose à cette universalité occidentale imposée.
– La créolisation : un processus imprévisible de contact culturel dans lequel aucune culture ne sort intacte mais dans lequel est créé du nouveau (le Tout-monde).
Et qu’en est-il du modus operandi ?
Durant le processus créatif, un travail corporel sensible a permis aux danseurs d’être à l’écoute de leurs sensations corporelles. Je les ai ensuite initiés au Gwoka, les invitant à entrer dans mon univers. J’ai ensuite créé un espace improvisé où ils pouvaient revivre le Gwoka selon leur individualité. Je leur ai également demandé de partager une phrase dans leur propre langue, leur langue du cœur, celle de leur pays de résidence ou celle de leurs parents, évoquant leur lien aux autres.
Chorégraphiquement, cela a pris la forme suivante.
– Chacun dans son cocon de solitude (les douches). Circulation sans contact réel.
– Le jeu d’ombres sur les cyclos. Il s’agit de créer une illusion dans laquelle est renvoyée tour à tour l’image du danseur et l’image du monstre.
– Dissipation des peurs. La dimension ludique apparaît avec un jeu de miroir entre les partenaires.
– Ce qui était ludique bascule dans un jeu de confrontation puis dans des duels à caractère martial.
– La réconcilation, le voyage vers l’ailleurs et les murs.
– Le tout-monde
Que signifie « Fringe » pour vous ?
Pour moi, « Fringe » évoque la frontière. C’est le désir de transcender les frontières aussi bien les frontières stylistiques que les frontières nationales. C’est le pas à franchir pour aller à la rencontre des autres. C’est aussi sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de sortir de sa routine. C’est d’autant plus important pour nous que nous vivons à une époque où la peur et la haine se propagent comme une traînée de poudre.
Que souhaiteriez-vous dire au public du Fringe d’Istanbul ?
Ce que j’attends du public quel qu’il soit, c’est qu’il accueille le spectacle en toute innocence, qu’il fasse confiance à son ressenti pas seulement à son intellect.
Je voudrais qu’il se dise qu’il est autant porteur de sens que le chorégraphe.
L’autre aspect qui est important à mes yeux c’est la nécessité d’un regard et d’une écoute dépourvus d’a priori. Ce festival, présente des styles différents, des imaginaires différents. Et c’est une chance d’avoir accès à cette palette artistique internationale.
A travers la diversalité c’est l’humanité qui entre en polyphonie. Pour emprunter l’image de l’orchestre, c’est le dialogue entre des instruments de différentes factures qui crée l’harmonie.